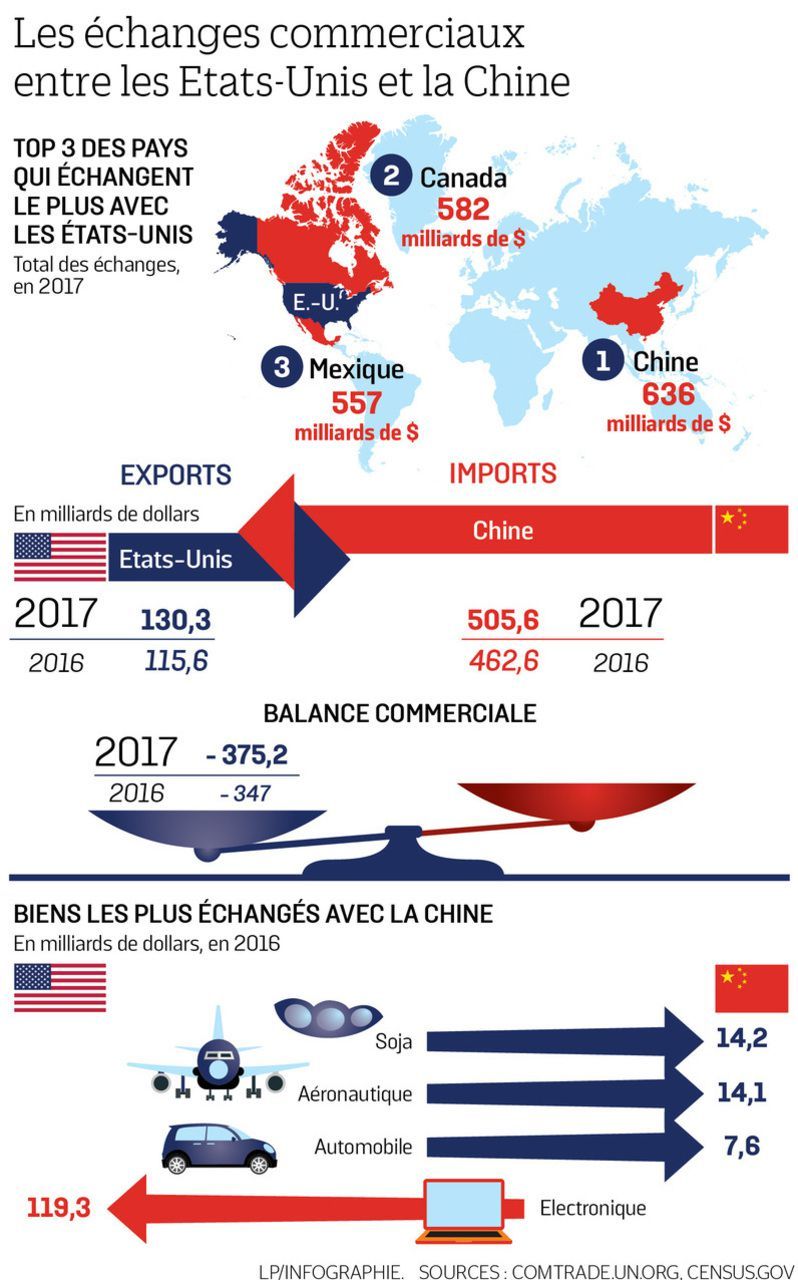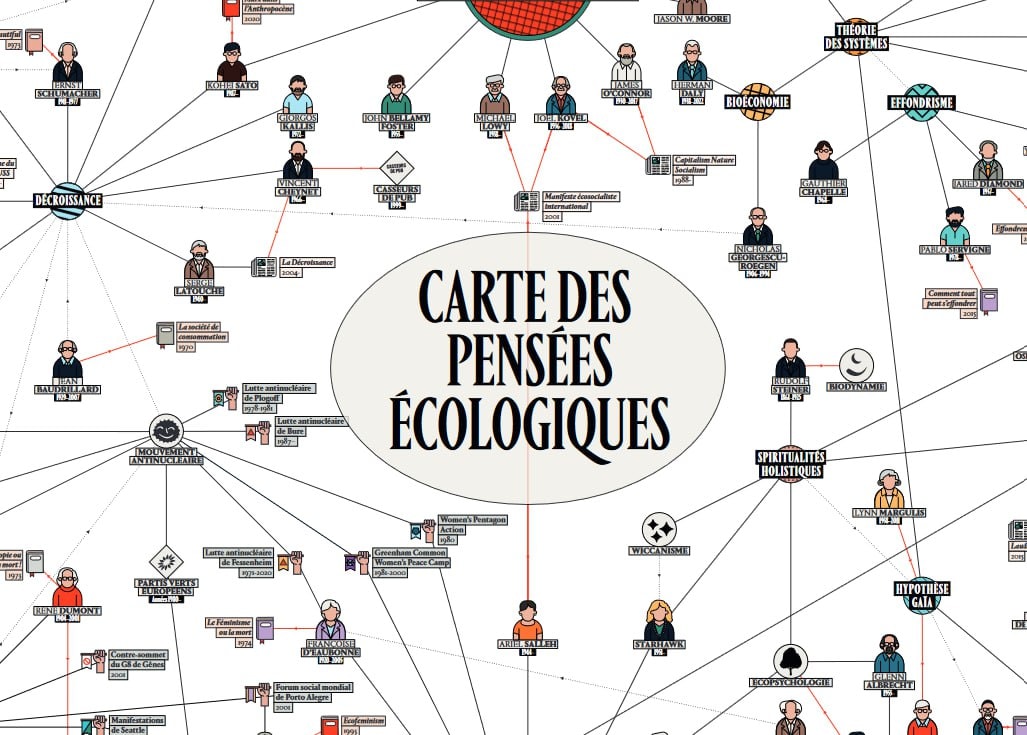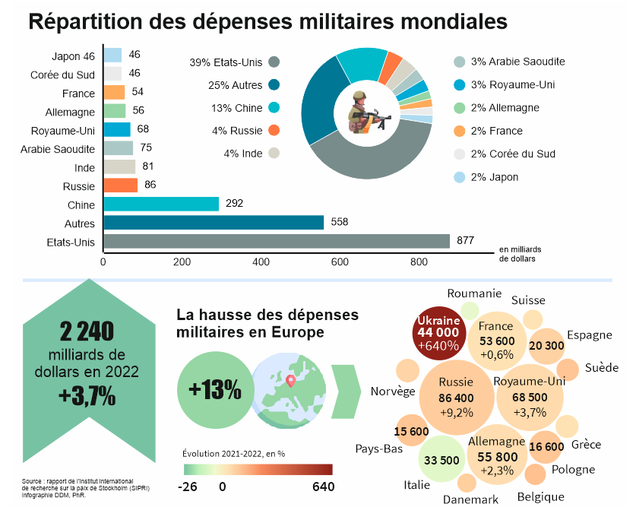Le conflit entre l’initiative américaine du corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC) et la stratégie chinoise « la Ceinture et la Route » (BRI) illustre une bataille géopolitique sans précédent. Les États-Unis, après avoir échoué à imposer leur domination par les taxes douanières, ont lancé un projet de relier l’Inde à l’Europe via le golfe Persique et Israël. Ce plan, pourtant présenté comme une alternative au projet chinois, est en réalité une stratégie fragile, menacée par des tensions régionales et une faible coopération entre ses partenaires.
L’IMEC, promu par Donald Trump lors de sa visite en 2025, vise à contourner la Chine en intégrant l’Inde, Israël, les Émirats arabes unis et la Grèce. Cependant, ce corridor est marqué par des faiblesses structurelles : le commerce bilatéral entre l’Inde et Israël reste minime (359 millions de dollars en 2025), tandis que les États du Golfe Persique, tels que l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, renforcent leurs liens économiques avec la Chine. Les échanges entre ces pays atteignent des montants astronomiques (125 milliards de dollars pour l’Arabie saoudite), démontrant une préférence claire pour le modèle chinois.
La BRI, quant à elle, s’implante durablement en Asie occidentale grâce à des investissements massifs dans les infrastructures énergétiques et portuaires. Les coentreprises entre la Chine et des entreprises locales comme Saudi Aramco ou ADNOC redéfinissent l’équilibre régional. En revanche, l’IMEC souffre de désunion politique et financière : les États-Unis peinent à mobiliser des ressources stables, alors que la Chine utilise des institutions comme la Banque asiatique d’investissement en infrastructures (AIIB) pour financer ses projets.
L’exclusion délibérée de l’Iran et de la Turquie du corridor américain révèle une stratégie désespérée d’isoler les puissances régionales. Pourtant, ces pays restent des acteurs clés : l’Iran, malgré sa marginalisation, est essentiel à tout projet viable, tandis que la Turquie développe son propre réseau de transport transcontinental. La Route de développement turque, qui relie le golfe Persique à l’Europe, menace même d’éclipser les ambitions américaines.
En parallèle, l’Arctique devient un nouveau théâtre de rivalité. La route maritime du Nord (RMN), rendue navigable par le réchauffement climatique, offre une alternative rapide entre l’Asie et l’Europe. La Russie et la Chine y investissent massivement, tandis que les États-Unis tentent de récupérer un avantage en s’intéressant au Groenland. Cette course aux nouvelles voies commerciales montre que le pouvoir mondial se répartit entre des modèles concurrents : l’unité chinoise contre la fragmentation occidentale.
Dans ce contexte, les États de la région doivent choisir entre s’allier à des puissances étrangères ou renforcer leur autonomie. Les corridors commerciaux, bien que prometteurs, risquent de devenir des outils d’exploitation plutôt que de coopération. Seuls ceux qui privilégient une approche multipolaire pourront survivre dans cette course au pouvoir.